Enquête sur le nucléaire français
25 - 28 avril 2011
En avril 2011 Antenne 2 a diffusé le 18 avril 2011 une excellente émission "Complément d'Enquête", intitulée
La catastrophe qui change tout
Au moment où j'écris ces lignes, après avoir pu travailler à partir de la diffusion de l'émission sur :
http://www.pluzz.fr/complement-d-enquete-2011-04-18-22h10.html
Au cas où ce fichier ne pourrait être consulté à cette adresse, en voici d'autres, signalées par mes lecteurs :
Beaucoup de lecteurs m'aident très efficacement, ne serait-ce qu'en me fournissant des informations utiles. C'est l'exception au milieu d'un océan de passivité.
En décembre j'avais sorti le livre "OVNIS et SCIENCE", pour renflouer les caisses de l'association UFO-science. Depuis août l'album de bande dessinée scientifique L'Ambre et le Verre (64 pages couleur), était mis à disposition (8 euros 50, port compris. Pas cher !). Ventes au profit d'une association Science et Culture pour Tous, jumelle de Savoir sans Frontières. Pour financer l'édition d'autres albums.
Les ventes ramaient. Une par jour. A ce train-là il faudrait un an de vente pour payer le tirage d'un autre album.
J'ai poussé un coup de gueule dans mon site. J'ai tout mis en croix pendant trois mois jusqu'à ce que l'argent demandé rentre. L'opération a été efficace pour OVNIS et SCIENCE. Il y a eu des ventes et des dons. Nous avons rentré de quoi poursuivre les recherches. Michel Padrines, qui avait organisé en septembre 2010 le colloque de Strasbourg, atteint d'un cancer généralisé, sort d'une chimiothérapie et entreprend de monter un colloque Astronomie - Science - Espace - Phénomène Ovni. Ca sera pour avril 2012, à Paris même. Nous suivons et ça prend bonne tournure. Cette fois, nous n'aurons que des "pointures".
Chapeau bas, monsieur Padrines !
Pour lui envoyer un message de soutien :
![]()
Cette fois, nous ne serons pas encombrés par les messages diffusés par des gens qui s'étaient livrés contre lui à une campagne de dénigrement absolument abjecte :
- C'est un escroc ! Il n'y aura personne ! Il va partir avec l'argent des billets ! Son cancer, c'est de la blague (...) !
Comment peut-on descendre aussi bas ? Cela vient de gens pour qui l'ovni était un petit business, une façon de se faire mousser au cours de dîners consacrés à "l'ufologie". Ma doué, quelle dégringolade, pour ces gens ! Dans ces dîners où l'assistance se raréfie, on ne trouvera plus que des inventeurs d'universons, des antigraviteux, des essayistes sur le retour, de lamentables boutiquiers, des responsables de services-fantômes. C'est fini, les clowneries, les pantalonnades.
28 avril 2011 : Un message de remerciement de Michel Padrines à l'adresse de ceux qui l'ont soutenu :
REMERCIEMENTS Vus les centaines de courrier reçus, je ne peux malheureusement répondre personnellement à tout le monde. Néamoins, je tenais à vous remercier de vos félicitations pour la réussite du premier congrès de Strasbourg, ainsi qu'à votre immense soutien dans les moments douloureux que j'ai traversé. Certains messages m'ont touché jusqu'au plus profond de moi-même, jusqu'à me faire pleurer. Je remercie Dieu de m'avoir donné le courage de me battre contre cette terrible maladie qu'est le cancer et redonné un moral d'acier, malgré les épreuves que je traverse encore. Vos messages également ont contribué à ma renaissance. Pour terminer je voudrais à mon tour vous faire connaître un poème de William Henley : Dans de cruelles circonstances, En ce lieu de colère et de pleurs, Aussi étroit soit le chemin, MERCI A TOUS Michel Padrines |
Revenons aux bouquins. Pour l'Ambre et le Verre, ça a été nettement plus mou. Aujourd'hui les ventes de cet album sont retombées à une par jour. Conclusion : c'est foutu. Il n'y aura pas de nouvel album Lanturlu imprimé. Quand des lecteurs me demandent "alors, l'album suivant, ça sera sur quoi ? " j'ai envie de leur rire au nez.
Vous ne savez pas la meilleure ! Cet album ayant pu être édité grâce à un sponsoring de l'hébergeur Free, nous disposions de 1000 exemplaires que nous devions adresser, en prenant le port à la charge de l'association, aux bibliothécaires (d'établissements scolaires ou municipaux) qui en feraient la demande. Savez-vous combien d'exemplaires nous avons pu diffuser, depuis l'impression de l'album, en août 2010 ?
Deux cent. Il nous en reste huit cent disponibles. Aucune demande depuis des mois. On baisse les bras.
Pourquoi ? Parce l'écho médiatique de cette opération, comme celle de Savoir sans Frontières en général, a été NUL. Le bouche à oreille entre bibliothécaires n'a même pas fonctionné.
Certains diraient "mais n'avez vous pas fait un mailing adressé à tous ces établissements ? ". Qu'on nous en fournisse le fichier. Le Ministère de l'Education Nationale le garde secret.
J'ai conçu l'album. Ma femme et moi l'avons mis en couleur (deux semaines de travail à plein temps, à deux). Ce résultat m'écoeure complètement.
L'opération est foirée et bien foirée. Il n'y aura pas d'autre album imprimé. Ou plutôt, il y en aura un autre. La société Eurocopter envisage de rééditer Le Passion Verticale, qui avait jusqu'ici été produite en 2007 pour une diffusion interne, et qu'on ne pouvait donc pas acheter. Là, à l'occasion de cette réédition ces gens auront la gentillesse d'envoyer 25% du tirage à l'Association Science et Culture pour Tous, une association "jumelle" de Savoir sans Frontières (créée pour l'occasion) qui pourra les vendre à son profit.
Ces superbes albums couleur seront vendus par correspondance, au profit de l'Association Science et Culture pour Tous. Mais pas en petit format. En grand format, à l'italienne, couverture cartonnée, pages de garde bleu marine. Poids : 750 grammes. Finies les préoccupation du coût d'expédition, d'un ajustement au format 15 x 20 broché, pour que ça puisse rentrer dans une enveloppe kraft et que le poids soit inférieur à 250 grammes, en essayant désespérément de s'aligner avec les prix des BD couleur "du marché" ( dans les 10 euros en librairie ). L'expédition coûtera ce que ça coûtera. Ces BD seront mises en vente au prix de 30 euros. Trois fois le prix d'une BD couleur en librairie. Les quelques centaines de fans de Lanturlu pourront les acquérir, puisque c'est là que se situe la clientèle de tels albums. Et à ceux qui trouveront le prix dissuasif, nous diront qu'il n'auront qu'à aller télécharger gratuitement la version noir et blanc sur le site de Savoir sans Frontière.
Science et Culture pour Tous en recevra un nombre nécessairement limité, et il n'y aura pas de retirage, simplement parce qu'un tirage de ce genre serait hors de portée des finances de l'association. Les collectionneurs devront faire vite.
Quand je vois ces ventes au compte-goutte, je me demande vraiment si cela vaut encore la peine d'encombrer ma page d'accueil avec cette image de la couverture de l'Ambre et le Verre, franchement.
Je veux bien que nombre des gens soient écrasés de soucis, de problème matériels. C'est parfaitement exact et c'est dans l'air du temps. Mais il n'y a pas que cela. Un vent de passivité, de résignation continue de souffler, chez ceux qui ont un emploi stable, une situation confortable. C'était de Gaulle qui disait " les Français sont des veaux ". Je ne sais pas s'il a raison, mais pour les Pertuisiens, c'est amplement démontré.
Il y a une dizaine de jours un prospectus a été diffusé, annonçant le projet de suppression du commissariat de Pertuis, alors que la délinquance monte en flèche dans la région, et dans la ville, que les commerçants se font braquer. Quelques jours plus tôt une bande organisée s'était introduite en ménageant un trou de 3 mètres sur 3 dans la toiture d'un magasin vendait des téléphones portables. La bande, très organisée, a neutralisé le système de sécurité et embarqué 200.000 euros de stock. Quelques heures plus tard tout cela passait une frontière quelconque, ou deux.
Voilà le prospectus :
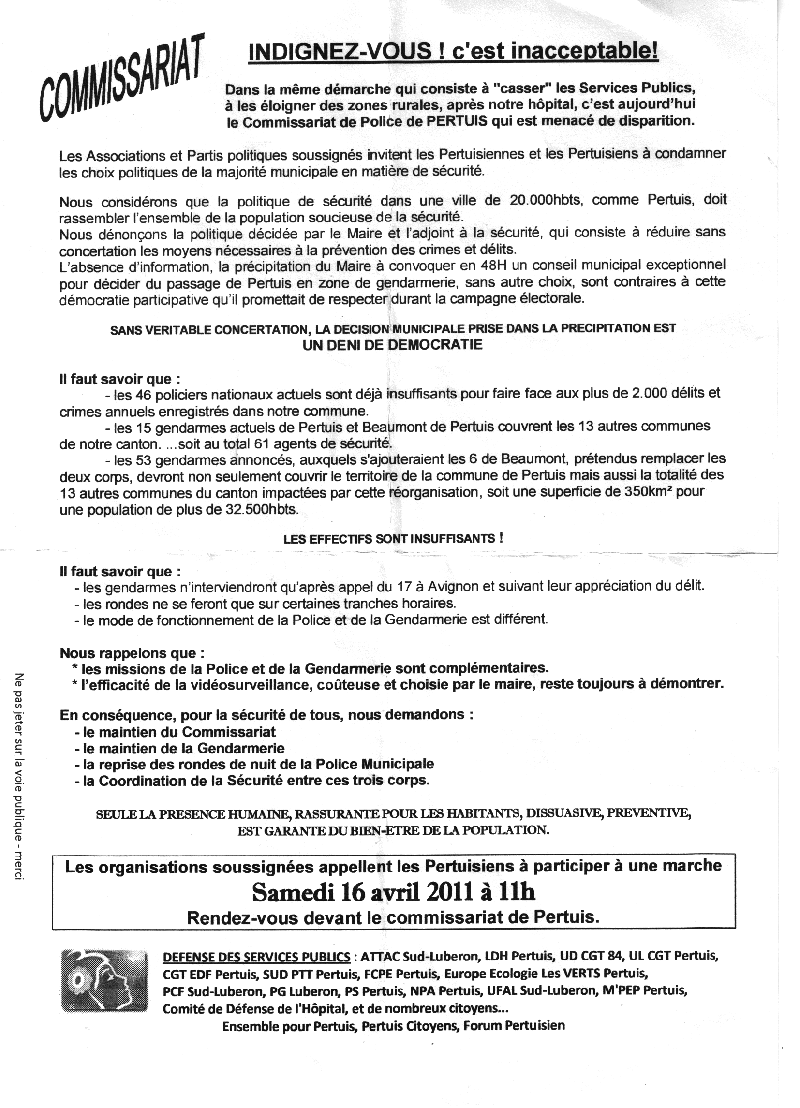 |
et voilà le résultat de cet appel, un samedi après-midi ensoleillé :

La foule compacte des manifestants, dans l'artère principale, devant le siège du commissariat

La même, avec en arrière-plan l'artère principale d'une ville de vingt mille habitants

Soixante personnes, dans une ville de 20.000 habitants ! ....
Cette affaire, qui n'avait aucune accointance ou connotation politique, intéressait tout le monde. Mais voyez la mobilisation impressionnante. Même les commerçants, les premiers concernés, brillaient pas leur absence, à une ou deux exceptions près.
Je ne sais pas si les Français sont des veaux, comme disait de Gaulle. Mais les Pertuisiens, sûrement.
Si vous vous comportez comme des veaux, on vous enverra à la boucherie.
Ca me semble assez bien parti
Je passe à l'exploitation de l'excellente émission "Complément d'enquête" su 16 avril 2011
Etat au 25 avril 2011
Le journaliste commence son enquête par des questions posées à Florent Vallier, jeune chef d'exploitation "de l'équipe 1", du réacteur de Nogent sur Seine. L'interview est menée dans une salle qui est la copie conforme de la salle de commande, et est utilisée pour la formation des personnels et les simulations.

Florent Vallier, chef d'exploitation de l'équipe 1 dans la centrale nucléaire de Nogent sur Seine

Dans la copie conforme de la salle de commande de la centrale de Nogent sur Seine
Il assure la sûreté et la production d'électricité de la centrale, pendant ses tours de garde

Le journaliste Benoit Duquesne qui mène cette enquête
Quand Benoit Duquesne questionne le jeune responsable sur sa réaction, après Fukushima, celui-ci lui répond en termes de "retour d'expérience", d'amélioration de la sécurité. On aura le même discours chez tous les gens en poste dans cette machinerie de l'électronucléaire français, la France étant "le pays le plus nucléarisé du monde.
Pourtant, s'empresse de dire Duquesne la France a connu des alertes sérieuses. Dans la nuit su 27 au 28 décembre 1999 la centrale nucléaire du Blayais, en Gironde, a été inondée, suite à la tempête qui a traversé la France, un phénomène totalement imprévisible.
EDF affichant "une attitude de transparence" Duquesne est reçu par Etienne Dutheil, le jeune directeur de cet ensemble, comprenant quatre réacteurs développant chacun 900 mégawatts.

Etienne Dutheil, jeune directeur de la centrale du Blayais, en Gironde
Face à la ligne de 400.000 volts qui achemine l'électricité produite
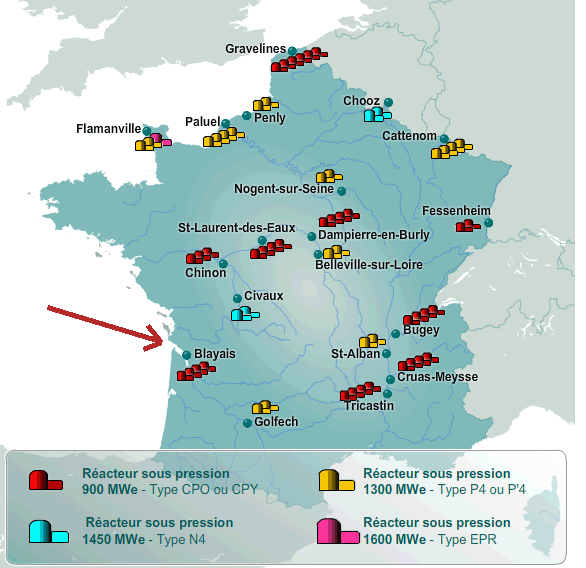
Localisation de la centrale de Blayais, à l'embouchure de la Gironde
Pour visiter la centrale, on s'équipe de dosimètres et on change complètement de vêtements.
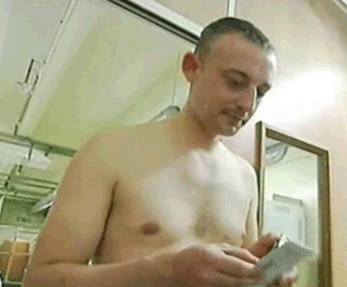
Le jeune directeur de la centrale, au vestiaire
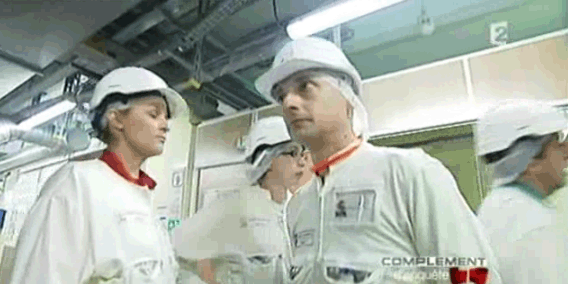
Equipé pour cette visite
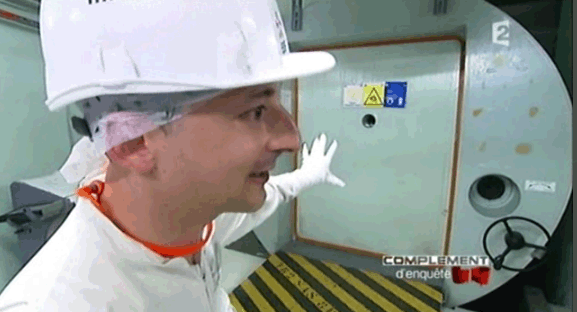
"Derrière une épaisse porte, le coeur : près de 80 tonnes de matière radioactive en fission",
une porte infranchissable quand le réacteur est en fonctionnement.
EDF accepte de faire visiter sa "piscine".

- Vous avez ici la piscine dans laquelle sont disposés les assemblages usagés, des réacteurs
Mon commentaire :
La "piscine" d'un réacteur est un bac empli d'eau ordinaire, quelques mètres suffisant à faire écran aux émissions de radioactivité provenant d'assemblages neufs, et surtout usagés. Ces éléments ont des formes prismatiques. Ceux des réacteurs de Fukushima font quatre mètres de long. Le coeur d'une centrale de type français en contient &&&. Le coeur est une enceinte en acier, de forme cylindrique, de 20 cm d'épaisseur, terminée par un fond et un couvercle amovible hémisphériques. Quand on procède au chargement d'un réacteur, un ponton roulant (de couleur orange sur la photo ci-dessus) transporte ces assemblages, pendus comme des jambons, et les dispose parallèlement, dans le coeur. Ils baignent alors dans une eau pressurisée, à une pression de 155 atmosphère. Cette eau, comme on le verra, a deux fonctions. C'est d'abord un "fluide caloporteur", qui va permettre de récupérer les calories produites dans le coeur et de les transporter vers un échangeur de chaleur. Elle circule à une température de 300°C. Elle servira alors à réchauffer un circuit secondaire.
Je crois utile de faire une parenthèse et de présenter le schéma de fonctionnement des réacteurs civils français "à eau pressurisée". L'eau à l'état liquide est un meilleur conducteur de la chaleur qu'à l'état de vapeur. Par contre la vapeur d'eau est un gaz, qui peut être détendu, dont la chaleur peut être convertie en vitesse, en énergie cinétique, donc faire fonctionner une turbine à gaz, laquelle est couplée à un alternateur, qui produira du courant électrique en 50 périodes et sous 4000 volts. Puis ce courant passe par un transformateur qui élève cette tension à 400.000 volts, ce qui aura pour effet de diminuer l'intensité électrique (qui croît comme le carré de l'intensité électrique, en vertu de l'effet Joule)d'un facteur cent, en vertu de la relation. :
P = puissance électrique = V1 I1 = V2 I2
La puissance dissipée par effet Joule sera donc réduite dans un facteur 10.000
Cette transformation sous haute tension permettra de réduire les pertes en lignes, pendant le transport du courant. Un transformateur, à l'arrivée, abaissera la tension jusqu'aux 220 volts de l'utilisateur domestique
Pour que l'échange de chaleur se fasse bien, à la sortie de cette turbine cette vapeur d'eau est retransformée en eau liquide dans un condenseur. Pour refroidir cette vapeur et la faire se transformer en eau liquide il faut évacuer des calories. Ces calories en excès, contenues dans la vapeur, sont transférées à l'eau d'un circuit de refroidissement. La vapeur évolue dans un circuit fermé. L'eau du circuit de refroidissement forme un circuit ouvert. Ce sont ces grandes tours dont l'aspect vous est familier. L'eau de refroidissement tombe en pluie dans une colonne d'air ascendant. L'air pénètre à la base de la tour et s'échappe en haut. Si on voulait tenter une comparaison, dans la tour se forme un nuage de gouttelettes et de vapeur d'eau. A la base de ce nuage, il pleut. Cette eau est récupérée. Mais la colonne d'air ascendant emporte une partie de cette vapeur d'eau. Les circuits des tours ont besoin d'être réalimentés, ce qui correspond au second tuyau bleu. La perte est de 500 litres par seconde. La vaporisation de cette eau représente d'une perte d'énergie. Aussi les centrales nucléaires travaillent-elles avec un rendement thermique relativement faible, de 30 %.
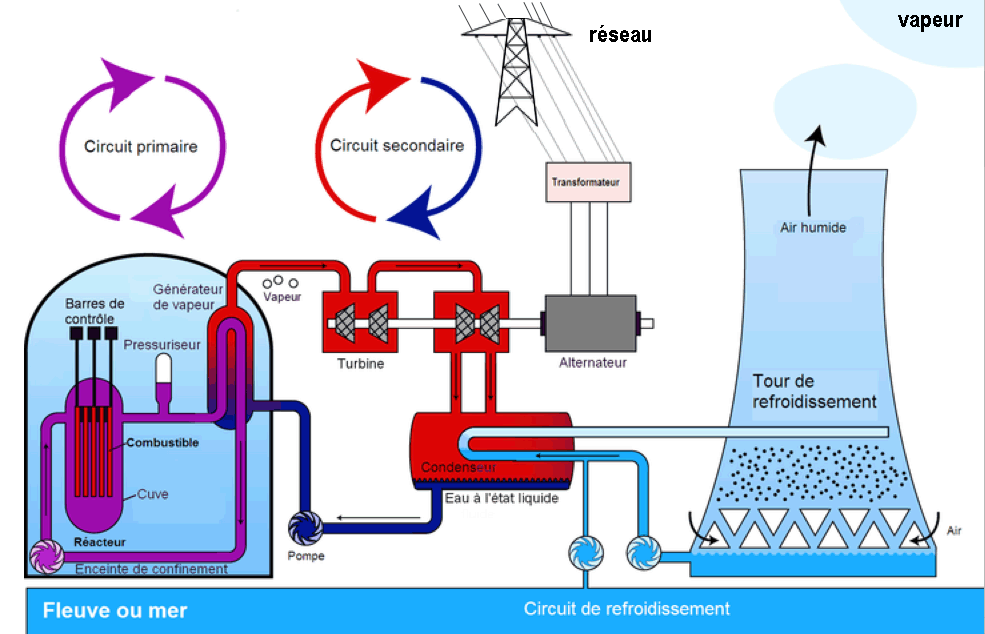
Soixante dix pour cent de l'énergie produite dans le coeur sert à chauffer les petits oiseaux.
Dans cette illustration, le circuit primaire, de l'eau qui passe dans le coeur, est en violet. Le circuit secondaire est en bleu/rouge. Bleu quand l'eau est à l'état liquide, rouge quand elle est à l'état de vapeur. On a fait figurer en gris les aubes des étages des turbines à gaz. Le circuit "tertiaire", "semi-fermé" est de couleur bleu-ciel. On voit, à gauche de la pompe de circulation, qui renvoie l'eau retournée à l'état liquide dans le condenseur, une seconde pompe qui prélève dans un fleuve ou dans la mer ces 500 litres par seconde évoqués plus haut.
Dans le coeur, en rouge, les assemblages prismatiques composant le coeur. Ils sont faits de "crayons", appelés aussi "gaines", en zirconium, qui contiennent des pastilles de "combustible nucléaire" en oxyde d'uranium. Ces pastilles ont le diamètre d'un cachet d'aspirine Cet oxyde a deux composants. 97 % correspond à de l'oxyde d'Uranium 238, non fissile et 3 % à l'oxyde d'uranium 235, fissile. C'est lui qui, en se décomposant, fournit de l'énergie, avec émission de neutrons. Les produits de fission sont radioactifs, toxiques. Parmi ces déchets dangereux, à durée de vie élevée, du Césium 137 et du Strontium.
Dans un fonctionnement normal, ces déchets restent dans les crayons en zirconium. Quand il y a "fusion du coeur", ils vont se mêler à l'eau de refroidissement, ce qui s'est passé à Fukushima, la société TEPCO ayant reconnu "qu'il y avait eu fusion partielle des coeurs (quand les éléments de leurs parties supérieures ont cessé d'être baignés par de l'eau de refroidissement, la vapeur étant incapable de remplir cette fonction, du fait de sa conductivité thermique plus basse).
Dans les réacteurs, après un an de fonctionnement, la richesse du mélange en oxyde d'uranium 235 baisse. Quand sa teneur descend à 1 % on cesse d'exploiter ce chargement. Le réacteur doit alors être "arrêté" et "déchargé".
On régule le régime de fonctionnement d'un réacteur à l'aide de "barres de contrôles" en cadmium, figurée au dessus du coeur, en noir. Elles absorbent les neutrons. Si on les descend complètement, les réactions de fissions cessent. Mais pas les réactions exothermiques de désintégration des produits de fission. Quand les barres sont descendues, il faut attendre un bon moment avant que la température du coeur baisse et qu'on puisse ouvrir la cuve et procéder au remplacement des éléments "usagés" ( avec 1% d'U235 ) par des éléments "neufs" avec 3 % d'U 235. Ces éléments usagés sont radioactifs, du fait des désintégration des produits de fission. Il faut les stocker dans ces fameuses piscines où l'eau a deux fonctions. Elle permet d'évacuer la chaleur dégagée par ces éléments, du fait de sa forte conductivité thermique, et elle sert aussi de barrière, vis à vis des radiations. Cette barrière est suffisamment efficace pour qu'on puisse se pencher sans risque au dessus de la surface de ces piscines. Les assemblages usés, ou en attente de chargement, sont disposés dans des casiers. Le documentaire de France 2 nous les fait voir ;
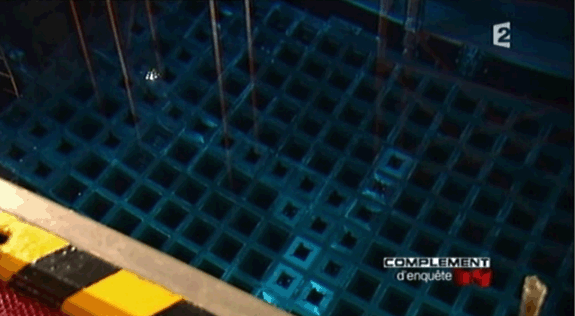
Les casiers qui permettent le rangement des "assemblages" dans la piscine
Si cette eau n'était pas là, non seulement les hommes présents prendraient de plein fouet les rayonnements ionisants, mais les éléments ne pourraient plus évacuer la chaleur qu'ils dégagent par simple circulation de l'air, qui est beaucoup point conducteur de la chaleur que l'eau. Les assemblages seraient endommagés. Les tubes de zirconium fondraient, comme cela s'est passé à Fukushima ("la Catastrophe qui change tout", titre de l'émission).
Au passage, pourquoi du zirconium et non pas du simple inox ? Parce que le zirconium ne freine pas les neutrons.
Je suis obligé de donner chemin faisant ces précisions techniques, sinon la suite du documentaire n'est que partiellement compréhensible. En décodant ce documentaire, vous comprendrez une chose. Si tous les projets continuent, en France, c'est "parce que la machine est lancée" et que revenir en arrière remettrait en je une politique lourde, avec tout un dispositif technico scientifique et des dizaines de milliers d'emploi.
A Fukushima, le séisme a entraîné l'arrêt des réacteurs. Les barres de contrôle ont été introduites dans les coeurs. Au Japon, ces barres montent, entraînées par des moteurs électriques. Elles traversent le fond des cuves en acier de 20 cm d'épaisseur.
Fukushima est vraiment "la catastrophe non prévue qui remet tout en question"
Une précision au passage. Dimension-type de la cuve d'un réacteur : 5 à 6 mètres de diamètre, dix mètres de haut.
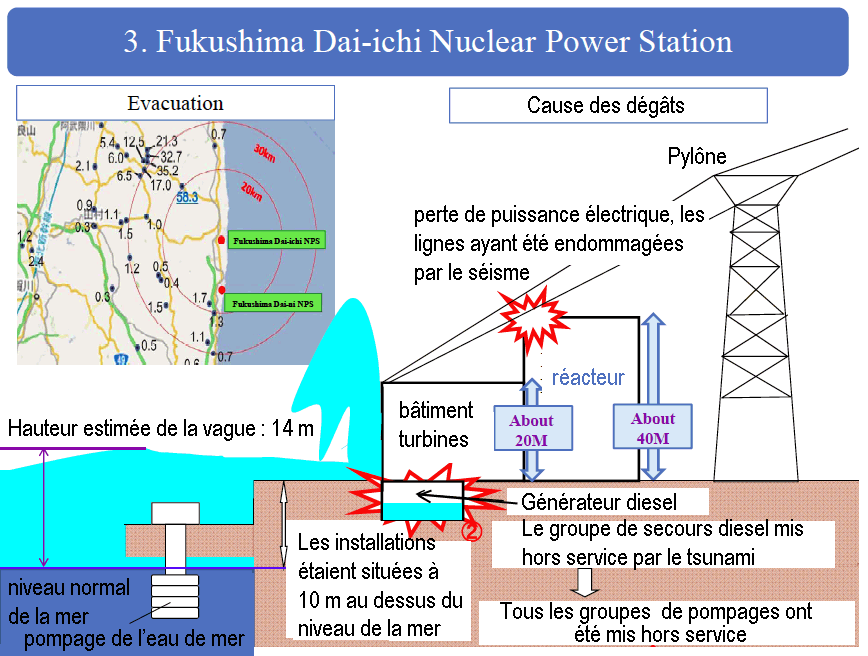
Illustration extraite du rapport officiel de TEPCO (je n'ai fait que traduire les légendes)
Au Japon, les barres sont donc montées, mais le tsunami a noyé les cuves à fioul alimentant les diesels de secours, cuves disposées par les Japonais en dessous du niveau plancher de la centrale (à 10 mètres au dessus du niveau de la mer. Mais, pas de bol, la vague du tsunami, à cet endroit, se traduisit par une montée de l'eau à plus quatorze mètres. Les quais furent donc submergés et les cuves à fioul noyées...
Comme on le verra dans le reportage effectué en France, les diesels, les pompes de secours et les cuves sont dans des locaux souterrains, donc "prêts à être inondés".
A Fukushima, les moteurs diesels ne pouvant être alimentés, s'arrétèrent. En sous-sol, ces groupes électrogène de secours s'arrêtèrent. Plus de courant, donc les pompes de circulation, également en sous-sol, comme au Blayais, s'arrêtèrent. L'eau des cuves des réacteurs cessa de circuler. La température monta. Idem dans les piscines, dont les éléments usagés cessèrent d'être recouverts par de l'eau. Les gaines de zirconium fondirent. Les déchets radioactifs se mélangèrent à l'eau, à la fois celle des piscines et celle qui normalement circule dans les coeurs.
Revenons à cette centrale du Blayais. Comme le reportage va nous le dire plus loin, en 1999 une tempête, imprévisible et non prévue, noya la centrale. Une tempête se traduit par un vent violent. Mais c'est aussi une dépression qui voyage. Celle-ci crée une "marée barométrique". Le niveau de l'eau s'élève. Le vent entraîne cette masse liquide vers la côte. En 1999 on est passé à côté d'une catastrophe, et vous comprenez pourquoi. Les diesels et les pompes de secours, en sous-sol, furent inondées. Par miracle, deux sur quatre continuèrent de fonctionner.
Cela aurait pu être bien pire si l'ouragan qui a traversé la région s'était produit quand les eaux étaient hautes, à un maximum de marée.
Le journaliste notera que le jeune directeur de la centrale fait de son mieux pour esquiver les questions concernant l'éventualité de la baisse du niveau de l'eau dans les piscines. Réponse du jeune Dutheil :

- Euh .... euh ... ça ne m'est pas possible de faire un parallèle sur le plan technique .... bla bla bla ... bla bla bla ..
Le directeur présente alors un "système de secours" (ridicule étant donné le volume de la piscine !) permettant de réaliser "un apport supplémentaire d'eau".

Pas très convaincant, ce système d'appoint d'eau, quand on considère le volume de la piscine.....
Bon sang. J'ai un bassin d'aquagym de 4 mètres cubes. Avec un tuyau d'arrosage il me fait 7 heures pour le remplir. Pourquoi le journaliste ne lui a-t-il pas posé la question :
- Avec ce bricolage, il vous faudrait combien de temps pour remplir votre piscine de plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes? Ca débite combien, votre truc ?
Après réponse de notre jeune directeur, le commentaire qui s'imposerait serait de dire "votre truc, c'est pour compenser l'évaporation ?"
Avec cette image, vous êtes spectateur de la CONNERIE à l'état pur
Un technicien ou ingénieur tente alors de faire une remarque, mais son supérieur, Etienne Duthiel, le prie vite de se taire.

Un technicien vite rappelé à l'ordre, dès qu'il tente de parler de Fukushima
- Euh ... non ... rien ... ça n'est qu'un montage ....
Je vais faire maintenant une autre remarque. A un moment vous aurez entendu le commentateur dire que le réacteur de Blayais est chargé avec du MOX, un combustible plus dangereux que le chargement classique à l'uranium enrichi à 3 %. Le MOX contient 7 % de ... plutonium. Ceci requiert quelque explications. Je vous ai dit plus haut que les coeur des réacteurs "classiques" étaient chargés avec un mélange de deux isotopes de l'uranium, le 238 et le 235. Seul le second est fissile. Les minerais naturel contiennent 99,3 % de 238, non fissile et 0,7 % de 235, fissile. Les minerai sont enrichis, en France, dans un vaste centre, à Tricastin, où on opère ce raffinage d'un minerai naturel, importé du Gabon et du Niger, par centrifugation. Un traitement chimique permet d'obtenir un composé d'uranium qui se présente à l'état gazeux ( un composé de fluor et d'uranium, U F6 ) .
Il est alors possible de faire migrer les espèces les plus lourdes vers l'extérieur de la centrifugeuse, l'uranium enrichi étant, moins dense, étant récupéré près de l'axe (le 235 est plus léger que le 238). L'enrichissement se fait par étapes successives, jusqu'aux 3 % de 235 requis pour faire fonctionner le réacteur civil.
Le fonctionnement de ces batteries de centrifugeuses consomme les 2/3 de l'énergie électrique des ... quatre réacteurs nucléaires de 900 MW, à eau pressurisée, implantés à Tricastin.
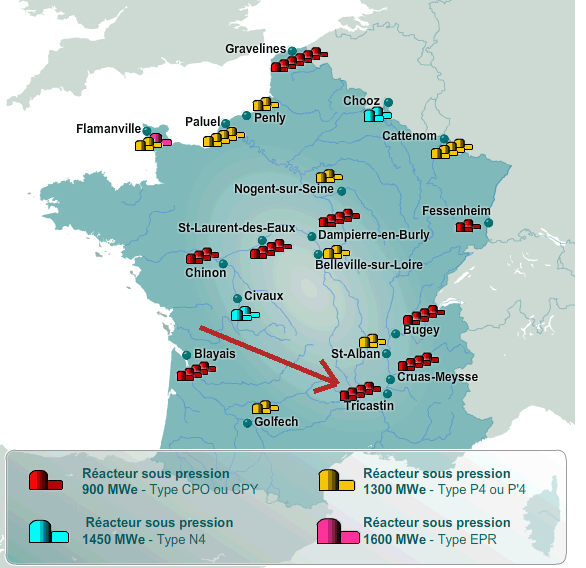 .
.
Localisation de la centrale de Tricastin, à proximité du Rhône, utilisant l'eau du barrage de Donzère Mondragon
Ces unités ont été mises en service en 1980, soit il y a trente ans. Initialement, la finalité du centre de Tricastin était de fournir des matériaux fissiles à usage militaire.
Un mot de commentaire quant au vieillissement des centrales. Les cuves (en acier, de 20 cm d'épaisseur) sont soumis à un intense flux de neutrons, qui disloquent le réseau des atomes de métal. Dans l'émission, on entend un responsable de l'EDF dire "plus nos centrales vieillissent, plus elles sont sûres". C'est faux.
La résistance mécanique des cuves diminue avec le temps.
Il a fallu des décennies d'expériences pour réaliser que les bombardements liés aux désintégrations avaient un effet sur les matériaux censés assurer leur confinement. Ce qui est valable pour l'acier des cuves l'est aussi pour le béton sans lequel on avait commencé à noyer les déchets, et qui a acquis une porosité, à cause d'une double phénomène de vieillissement, chimique et lié à l'irradiation.
Actuellement, au centre de la Hague on noie les déchets radioactifs dans des résines, sans avoir le recul qui permettra de savoir si leur confinement à long terme pourra s'avérer efficace. Ces gens n'en ont cure.
Mais revenons au cycle de vie de l'uranium. Les réacteurs étaient initialement chargés avec des oxydes contenant 3 % d'Uranium 235. Au bout d'un temps de l'ordre de l'année, la richesse en 235 tombe à 1 % et la densité de cet isotope n'est plus assez élevée pour que les réactions de fission puissent se produire (la probabilité de rencontre des neutrons émis par la fission avec des boyaux d'U235 devient trop faible pour que les réactions en chaîne se produisent). La quantité d'énergie délivrée par les réactions de fission diminue alors rapidement. La puissance thermique délivrée par le coeur diminue. Au bout d'un an les assemblages contiennent de l'Uranium 238, 1% de 235, et du plutonium 238 obtenu par capture d'un neutron par l'Uranium 238.
Ici, nous ferons une parenthèse sur deux types de réacteurs
- A neutrons lents
- A neutrons rapides
Les réactions de fission produisent des neutrons qui filent à 20 km/s. Cette vitesse est optimale pour que s'opère leur capture par les noyaux de 238, pour produire du plutonium. Cet atome n'existe pas dans la nature (sauf la célèbre exception d'Oklo, au Gabon), car à l'échelle des temps géologiques sa durée de vie est trop brève. Il ne vit que 24.000 ans.
Le plutonium existant sur Terre est donc principalement lié aux activités humaines.
C'est une substance d'une radiotoxicité maximale. Si une particule est ingérée ou inhalée par un être humain, elle va produire du rayonnement ionisant qui va dégrader les structures biomoléculaires environnantes, affecter l'ADN et provoquer des cancers. Le plutonium a la propriété de se fixer durablement dans les tissus vivants. Sa "demi-vie biologique" est de 200 ans. Si une personne absorbe 1 milligramme de plutonium par inhalation, décès assuré. .
A titre anecdotique, la façon dont les Américains s'y prirent pour avoir la preuve de la toxicité de cette substance fut de l'injecter, à leur insu, à des jeunes recrues de l'armée des Etats-Unis. Cette expérience fut menée avec l'accord écrit d'Oppenheimer, le père de la bombe A américaine.
Le plutonium est par essence l'explosif utilisé pour fabriquer des bombes A, à fission, mais pas seulement, comme on le verra plus loins, parce que parce que sa masse critique est inférieure à celle de l'uranium 235. On fabrique ce plutonium à usage militaire en faisant fonctionner des réacteurs "à fort régime".
Comment régule-t-on le régime d'un réacteur, c'est à dire la vitesse moyenne des neutrons ? En utilisant un modérateur, qui ralentit les neutrons. Pour l'uranium 235 on obtient un rendement de fission meilleur avec des neutrons lents, ne cheminant qu'à 2 km/s. Le meilleur ralentisseur de neutrons c'est l'eau lourde, de l'eau où les atomes d'hydrogène sont des atomes de deutérium. Un isotope de l'hydrogène où le noyau est composé d'un proton et d'un neutron. Cette efficacité de l'eau lourde, connue dès avant la seconde guerre mondiale a donné naissance à la "bataille de l'eau lourde", celle-ci étant produite en Norvège.
En utilisant l'eau lourde comme ralentisseur de neutrons, il est possible de faire fonctionner un réacteur avec du minerai naturel, contenant 0,7 % d'uranium 235.
Un second modérateur, abondamment utilisé dans ces premières "piles atomiques" est le graphite. Les réacteurs de Tchernobyl étaient des réacteurs où des barres d'uranium étaient inserrées dans un grand bloc de graphique, tout en étant refroidies par de l'eau (légère).
Troisième modérateur : l'eau légère. L'usage d'eau comme modérateur présente un avantage, utilisé par les Français, avec leurs réacteurs à eau pressurisée, et par les Américains avec leurs "réacteurs à eau bouillante" : de pouvoir servir de fluide caloporteur".
Auto-stabilité des réacteurs à eau
Le graphite ne se dilate pratiquement pas à la chaleur. L'eau, si. La dilatation accroît la distance séparent les molécules d'eau. Ce sont les collisions entre ces molécules et les neutrons émis par la fission qui ralentissent ces derniers. Il est alors possible d'envisager d'utiliser cette propriété pour déboucher sur une certaine auto-stabilité des réacteurs dont l'élément modérateur est l'eau.
En effet, supposons que les réactions de fission croissent en nombre, que le rythme des fissions s'élève. La production de chaleur sera plus importante, à débit de pompage égal. L'eau va se dilater. Les molécules d'eau formeront alors un milieu moins dense. Un neutron, traversant une conduite emplie de cette eau, aura moins de chance d'être ralenti en interagissant avec un molécule.
Les neutrons étant moins ralentis, le rythme des fissions va baisser.
Feed back négatif, autostabilité.
Les réacteurs de Tchernobyl ne possédaient pas cette propriété d'autostabilité et étaient au contraire très instables à bas régime. Voyez le détail sur Wikipedia.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catastrophe_de_Tchernobyl
Les armes nucléaires tératogènes, à effet différé
Il faut dépenser de l'énergie pour enrichir l'uranium extrait du minerai naturel, par centrifugation. On vise donc un optimum et on tombe sur cet enrichissement à 3 % de 235. On pourrait obtenir un meilleur pourcentage de 235 en poursuivant la centrifugation. Mais alors on dépenserait trop d'énergie, alors qu'avec 3 % les réacteurs fonctionnent.
Au passage, quand on enrichit par centrifugation de l'uranium, on obtient d'un côté un mélange plus ou moins enrichi en 235 et, par voie de conséquence, résultant de cette "distillation", de l'uranium appauvri, contenant moins de 0,7 % de 235.
Le minerai naturel n'est pas foncièrement dangereux. A l'état natif, il n'est pas susceptible de connaître des fissions par réactions en chaînes. L'uranium, même à faible pourcentage de 235, à l'état naturel, n'est pas bon pour la santé, de même que tous les métaux lourds. Il présente la même toxicité que le plomb. Mais l'uranium a une propriété mécanique qui a tout de suite intéressé les militaires. Alors qu'il est plus dense que le plomb (19,1 gr/cm3 contre 11,35 gr/cm3), il n'est pas mou comme ce dernier. Il est aussi pyrophorique, s'enflamme à haute température. C'est donc le projectile antichar, anti-blindage idéal. A l'intérieur du char il s'enflamme et tue l'équipage. Mais cet uranium appauvri a aussi des propriétés tératogènes. Il affecte les testicules des mammifères et de l'homme et dégrade leur descendances (engendrement de monstres ), ce qui permet de "punir l'ennemi", militaires ou civils confondus (Irak, Kosovo et autres lieux).
L'usage des obus à uranium appauvri représente la mise en oeuvre d'armes nucléaires à effet différé.
Des réacteurs fonctionnant au plutonium
La réaction plutonigène est favorisée lorsque les neutrons sont rapides. Les réacteurs plutonigènes, utilisés à des fins militaires, se fondent sur une modération limitée. Les neutrons rapides frappent alors une "couverture fertile", en uranium 238, lequel se transforme par capture en plutonium 239.
Le plutonium 238, comme l'uranium 235 est fissile, et les réactions en chaîne, en son sein, se produisent plus aisément avec des neutrons rapides. On pourrait dire que le plutonium est
à utiliser sans modération
Ces réacteurs ne sauraient utiliser un fluide caloporteur comme l'eau, qui est elle-même un ralentisseur de neutrons. On débouche alors sur des réacteurs qui sont contraints d'utiliser un fluide caloporteur qui soit "transparent aux neutrons", ne les absorbent ni ne les ralentissent, et ce fluide c'est le ... sodium.
Le réacteur français Phoenix, notre premier sugénérateur, est donc né de cette brillante idée. Celui-ci a été raccordé au réseau EDF en 1974. Avant son arrêt c'était le plus ancien réacteur nucléaire en France. Son démantèlement est prévu, mais le coût estimé est d'un milliard d'euros.
Le coût pharamineux des démantèlements
Pourquoi un démantèlement coûte-t-il si cher ? Parce qu'au cours de son fonctionnement un réacteur nucléaire crée de la radioactivité induite dans toutes ses structures, dans la moindre tubulure, le moindre robinet. Tout devient réadioactif. Démanteler ne se limite pas à "enlever la charge de combustible radioactif". C'est l'ensemble de la structure qui se transforme en poison à longue durée de vie. Il faut démonter la centrale pièce après pièce, transformer tout cela en déchets de taille assez modeste pour pouvoir être conditionnés et stockés.
Un casse-tête complet, ruineux.
L'extrême dangerosité des surgénérateurs à neutrons rapides
Pour faire fonctionner un réacteur au plutonium et lui faire produire cette même substance par bombardement à l'aide de neutrons rapides, on ne peut pas utiliser l'eau comme fluide caloporteurs, car cette eau ralentit les neutrons. Il faut donc utiliser le sodium, qui est loquide à 550° et bout à 880°C.
Le sodium possède une propriété bien connue des chimistes : mis en contact direct avec l'air, il s'enflamme spontanément. Si on l'arrose, c'est pire : il explose. On ne sait simplement pas éteindre des feux de sodium de plus de quelques centaines de kilos.
Ajoutez la dangerosité absolue de la charge de plutonium.
Un réacteur au plutonium contient de quoi tuer un million de personnes.
Mais ces réacteurs à neutrons rapide peuvent transformer de l'uranium 238 et ... plutonium 239. D'où cette appellation de Phoenix, cet oiseau qui renaît de ses cendres. Par la suite, nos nucléocrates ont conçu et construit Superphoenix, un monstre contenant 5000 tonnes de sodium et une tonne de plutonium. Les manifestants anti-nucléaires tentent de s'opposer à sa construction, à sa mise en marche. Les réaction policières sont violentes. Un manifestant est tué. Les "forces de l'ordre" lui tirent à bout portant une grenade lacrymogène en pleine poitrine.
Mais la nature apporte sa sanction au projet. Le réacteur est implanté en Isère, à Creys Malville. Un jour de 1998, suite à une abondante chute de neige, le toit abritant les turbines, les pompes, mal calculé, s'effondre.
Le réacteur est arrêté.
Mais pour EDF et les nucléocrates, ça n'est que partie remise. En effet le surgénérateur s'inserre dans un plan d'indépendance énergétique qui est complété par la construction de l'usine de retraitement des déchets de la Hague. Je vous avais dit que lorsqu'on procède au déchargement du coeur d'un réacteur, celui-ci contient différents éléments, sous forme d'oxydes. L'uranium est présent sous la forme de ses deux isotopes, la richesse en 235 étant tombée à 1 %. Il y a les radionucléides qui sont issus des fissions, et qui sont radiotoxiques. Il y a enfin du plutonium, issu des captures de neutrons par les noyaux d'uranium 238.
En fin de cycle de fonctionnement le coeur d'un réacteur contient 1 % d'uranium 235 et 1 % de plutonium 239
Jusqu'au lancement de l'usine de retraitement de la Hague, où là encore "le Français sont leaders ", ce mélange, issu du déchargement des réacteurs, était considéré comme un déchet à stocker. Mais les Français ont développé des techniques qui permettent d'une part d'isoler les déchets de fission, qui sont "noyés dans de la résine". J'avais écrit que le plutonium était extrait par centrifugation, mais un lecteur m'a signalé mon erreur. Le plutonium 239 n'est pas un isotope de l'Uranium 238, c'est une substance chimiquement différente, qui présente des affinités chimiques différentes vis à vis d'autres corps. Le noyau d'uranium contient 92 protons, donc son cortège électronique est composé de 92 électrons. Ce chiffre passe à 94 pour le plutonium.
L'effectif du cortège électronique d'un atome déterminant ses propriétés chimiques, il s'agit donc de deux substances chimiquement différentes.
Sur la récupération du plutonium :
http://www.laradioactivite.com/fr/site/pages/InventairePlutonium.htm
On extrait donc le plutonium par voie chimique, ce qui est plus facile et moins coûteux que d'extraire l'Uranium 235 par centrifugation. Un lecteur nous donnera plus de détails sur la méthode et son coût. C'est ainsi qu'on procédait pour extraire le plutonium produit dans les réacteurs à usage militaire, dans les "couvertures fertiles". C'est aussi pour cela que l'usage du plutonium s', pour la conception de bombes A, à fission, par rapport aux bombes à uranium. Il est moins coûteux de produire du plutonium par combardement, dans une couverture fertle, que d'atteindre le pourcentage d'Uranium 235 requis (90 % ) en procédant à un raffinage coûteux et interminable. Parce que l'extraction du plutonium par voie chimique est plus aisé et moins coûteuse.
Le "MOX" procède de la même logique. Celui-ci contient 7 % de plutonium. Utiliser le plutonium comme élément fissile, comme "combustible" accroît terriblement la dangerosité du fonctionnement des centrales.
Mais c'est moins cher et plus rentable. Alors ce critère prévaut, au détriment de la sécurité
Il faut ajouter que cette récupération de plutonium dans des stocks issus des chargements de réacteur étaient fait pour fonctionner en symbiose avec la formule du surgénérateur à neutrons rapides. Le surgénérateur consistait à faire fonctionner un réacteur à fission "à haut régime", c'est à dire sans modérateur, donc avec du sodium comme fluide caloporteur. La charge de plutonium aurait été le siège de fission, mais les neutrons libérés auraient refabriqué du plutonium à partir de l'uranium 238 ambiant.
Sur le papier, avec des chiffres, tout cela est fort intéressant. Dans la pratique cela revient à programmer le suicide ou l'extermination des populations, un accident de surgénérateur pouvant être mille fois plus grave que celui de Tchernobyl.
Pour le moment, donc, le projet d'implantations de surgénérateurs en France est gelé. Le MOX est aussi une façon de faire fonctionner l'usine de la Hague " en attendant que la situation se débloque et que le feu vert soit donné pour la construction des surgénérateurs", rebaptisés "réacteurs de IV° génération". La France fabrique donc, utilise du MOX et le vend. Le réacteur numéro III de Fukushima était chargé au MOX. L'EPR est conçu pour fonctionner au MOX à 100 %.
Ce mélange a tous les défauts. Les assemblages sont 5 fois plus radioactifs que l'uranium enrichi. Le temps catactéristique de refroidissement des assemblages usagés atteint le chiffre vertigineux de 50 ans ! Et en cas d'accident, c'est l'horreur absolue. Vous avez vu le film de l'explosion du réacteur numéro 3, à Fukushima. L'enceinte est-elle endommagée ? Cette marmite d'acier a-t-elle pu rester intacte après une explosion d'une telle violence, qui a projeté les débris de béton de la couverture à des centaines de mètres de hauteur. Cette explosion est suspecte. Dans le réacteur numéro 1 l'examen des restes semblent bien montrer que l'explosion n'aurait intéressé que la salle supérieure, située au dessus du réacteur. Mais pour le numéro 3, quels sont les dégâts ? La cuve est-elle fissurée ? TEPCO semble l'admettre.....
De toute manière, pour éviter l'explosion, les Japonais ont d'abord refroidi le coeur à l'eau de mer, puis ont pratiqué un refroidissement avec dispersion du contenu de la cuve, dont 30 % des assemblages avaient fondu. Les eaux de refroidissement de ce réacteur numéro 3 contiendraient du ... du plutonium !
Suite du reportage sur la centrale de Blayais, âgée de 30 ans, durée de vie nominale d'une telle installation. Le journaliste demande si la vie de cette centrale va être prolongée. Pour son directeur, Etienne Dutheil, la question ne se pose même pas :

- Bien qu'âgée de 30 ans, la centrale du Blayais sera prolongée, car c'est une centrale sûre, qui a été constamment modernisée
Cette prolongation devrait étendre la durée de vie de 30 à 60 ans. Et elle fonctionnera au MOX, avec un coeur chargé avec 7 % de plutonium. Le chargement avec ce type de combustible a déjà été opéré.
Comment voulez-vous espérer qu'Etienne Dutheil puisse avoir sur ce sujet un point de vue critique, ou simplement objectif, alors toute sa carrière dépend de la position qu'il choisit d'adopter ? Ses impératifs de carrière lui interdisent même d'avoir une opinion différente. S'il avait exprimé des critiques vis à vis de "sa" centrale, il n'aurait pas tardé à être muté. A la limite, il réussit à se convaincre de ses propres propos. Et il en est de même pour tous les "responsables" qui seront interrogés au cours de cette émission. Le côté "nous sommes une grande famille (de privilégiés") annihile toute prise de recul vis à vis de cette "adhésion au nucléaire".
L'enquêteur rend alors visite à un écolo, Patrice Lapouge, qui vit à proximité de la centrale et développe devant lui ses idées concernant la dangerosité de l'installation.

La confrontation entre deux univers. Celui d'Etienne Dutheil et celui de Patrice Lapouge, écologiste
Patrice Lapouge, qui habite à proximité de la centrale explique que celle-ci est située sans un véritable entonnoir vers lequel converge tout le système hydrographique de la région d'Aquitaine :

Vulnérabilité de la centrale de Blayais vis à vis d'un accident météorologique
- Les gens qui ont construit cette centrale dans un lieu aussi vulnérable ont refusé de voir la vérité en face
On verra plus loin la réponse d'Etienne Dutheil, qui montrera le barrage érigé à la suite de l'inondation de 1999. Il ajoute "que ce barrage pourrait maintenant largement faire face à l'événement connu cette année-là". Mais, dans ce discours on discerne une incapacité complète à anticiper (est-ce que ce type a la tête d'un type capable d'anticiper ?). Ci-dessus, l'écologiste évoque "la catastrophe maximale". C'est à dire la simultanéité de différents facteurs.
- Des précipitations considérables dans tout le bassin d'adduction hydrologique
- Une violente tempête, comme celle de 1999
- Le tout se produisant à une époque de "grandes marées" (alors que l'événement de 1999 s'est produit, coup de chance, à une époque de basses eaux)
Face à cela, Dutheil pourrait répondre :
- Là, vous ne poussez pas le bouchon un peu loin ? Il faudrait quand même que toutes ces catastrophes surviennent en même temps. Et la probabilité ....
La probabilité : une réponse-type de polytechnicien, adepte de la philosophie "de l'inexistence du risque zéro".
Mais qui aurait imaginé que survienne, en 1999, une tempête d'une telle violence ?
Il reste qu'en dépit de cet incident, " qui pourrait maintenant être bien géré ", les pompes de secours, les groupes électrogènes, les cuves de fioul resteront en sous-sol, vulnérables à de tels événements (comme ce fut le cas à Fukushima). Sans doute, modifier les installations serait-il trop coûteux. Si à Fukushima on avait placé (à défaut de le faire pour l'ensemble de l'installation, ce qui aurait été faisable, sur des collines jouxtant le site) le système de secours, cuves à fioul, diesel, l'ensemble du groupe électrogène, dix ou quinze mètres plus haut (ce qui aurait été logique dans un pays où le mot tsunami a été inventé) et si on avait donné à l'ensemble des capacités de résistances antisismiques maximales, le système de pompage de secours n'aurait pas été mis HS par le tsunami.
- Mais qui aurait pu prévoir un tsunami d'une telle ampleur ? .....
- Qui aurait pu prévoir une tempête d'une telle ampleur ?
- Qui aurait pu prévoir que ces phénomènes (cités plus haut) auraient pu se produire simultanément ?
Etc .....
La liste des "phénomènes improbables" n'est pas exhaustive. Des ras de marée, dont un relativement récent, qui s'est produit seulement il y a quelques années, et qui a affecté les côtes portugaises, peuvent se produire, non à cause d'un séisme, mais à cause d'un glissement de terrain sous-marin. Il s'en est produit dans de nombreuses régions du globe, en étant accompagné de ras de marée parfois monstrueux. Quand Claude Allègre, spécialiste de la tectonique des plaques dit dans une interv,iew reproduite par le Point, dans un numéro spécial consacré au nucléaire "il faut arrêter de marcher sur la tête. Il n'y aura jamais de tsunami en France", il s'avance. Quand il déclare que la France n'est pas une région à séisme, il dit tout simplement des conneries. Voir plus loin ce qui a trait par exemple à Grevelines, dans le Pas de Calais.
La propriétés des tsunamis et s'exercer leurs ravages à des distances illimitées, se chiffrant souvent en milliers de kilomètres. Historiquement, des ras de marée impressionnants ont été créés, non pas par des événements sismiques, mais par des glissements de terrain sous-marins. Ce sont alors les rivages présentant des remontées de fond très progressives qui permettent à cette onde, de faible ampleur et de très grande longueur d'onde, de se renforcer au voisinage des côtes. Cela pourrait être très bien le cas, comme me le faisait remarque Xavier Lafont, pour le centrale de Gravelines "qui a les pieds dans l'eau", destinées à une production de courant en vue d'une exportation au bénéfice de l'Angleterre et pour laquelle aucun dispositif anti-tsunami n'a été prévu et où il y a gros à parier que les systèmes de secours, en sous-sol, sont ... inondables.
Gouverner, c'est prévoir
En annexe, le rapport de l'Assemblée Nationale sur l'incident de 1999
Retour sur la centrale de Gravelines :
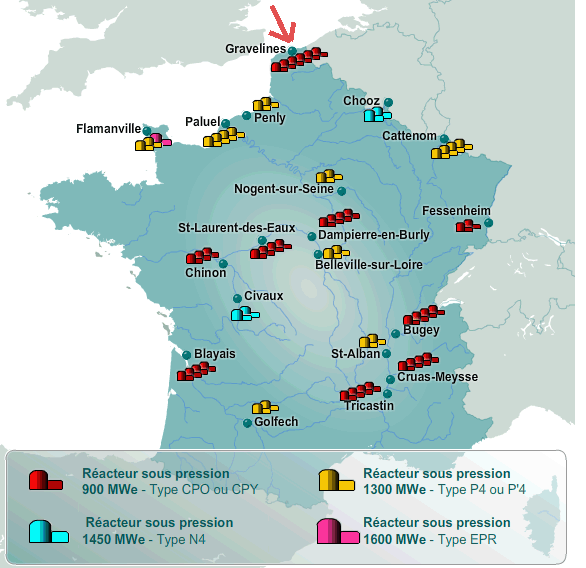
La localisation de la centrale de Gravelines, dans le Pas de Calais, "les pieds dans l'eau".
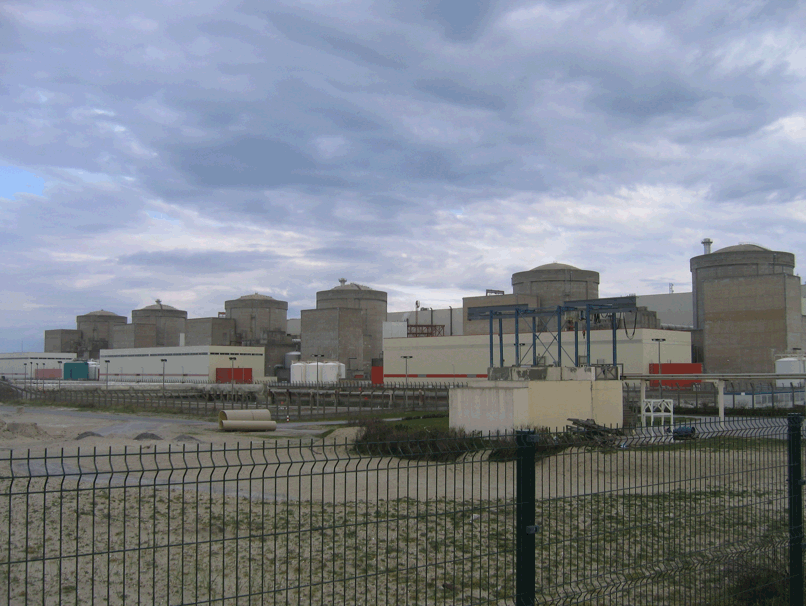
La centrale de Gravelines, Pas de Calais, près de la plage. Six réacteurs dénués de toute protection
Lors d'un récent passage à la télévision, et dans une interview donnée dans le numéro spécial du Point l'ancien ministre Claude Allègre a déclaré qu'un scénario comparable à celui de Fukushima ne saurait se produire dans un pays comme la France "où il n'y a pas de zones à forte sismicité".

- Il faut arrêter de marcher sur la tête ! La Fance n'est pas un pays à forte sismicité !
Une telle phrase pourrait nous rassurer quant aux risques encourus pour ce site de Gravelines. Pourtant, un coup d'oeil dans une encyclopédie nous montre que la région a connu un fort séisme en 1580. Ceci m'a été signalé par mes lecteurs.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tremblement_de_terre_de_1580
Sa magnitude a été évaluée, sur l'échelle de Richter, entre 5,3 et 6,9 . Il est intéressant de voir où se situe l'épicentre :
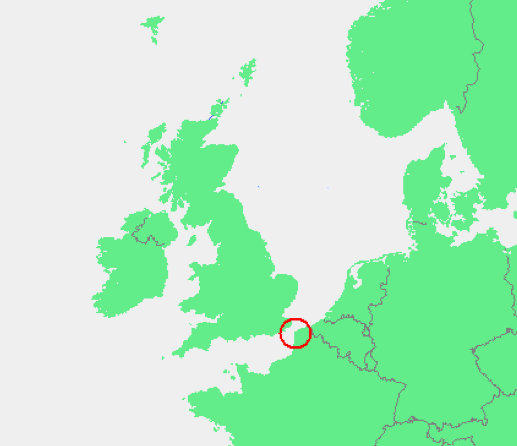
L'épicentre du séisme de 1580 coïncide avec le site de la centrale de Gravelines !
Mais peut être Allègre ignore-t-il cet événement du passé ?
La centrale de Blayais, en Gironde, a été mise à mal par un ouragan, qui a traversé la France du Sud ouest au Nord Est. Mais pourquoi pas l'inverse ? A-t-on prévu que les groupe électrogènes de secours des réacteurs de Gravelines, vraisemblablement installés eux aussi ... en sous-sol, pourraient être mis HS par immersion ??
L'équipe de la chaîne cherche à savoir ce qui s'est passé à la centrale de Blayais, en 1999. EDF demande au personnel de l'époque de "rejouer la tempête" sur simulateur. Les acteurs de cette scène affirment ne s'être jamais sentis en insécurité, à leur poste de commande.
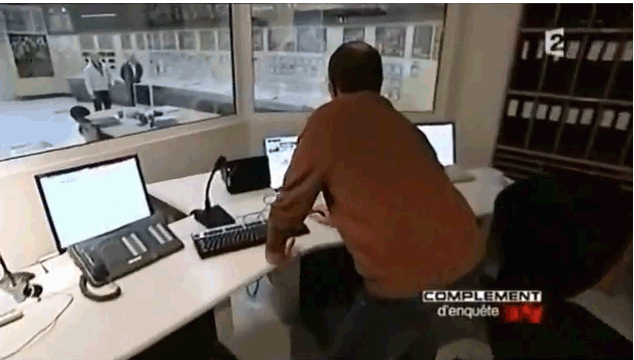
L'équipe de l'époque nous rejoue, sur simulateur, la grande scène de l'inondation de 1999
Le directeur et un de ses techniciens emmènent alors l'équipe de télévision dans les sous-sols de la centrale de Bayais, où sont situés différents dispositifs, dont les dispositifs de secours, c'est à dire les groupes électrogènes et les pompes destinées à entretenir la circulation d'eau dans les coeurs. En 1999 l'inondation provoquée par la tempête avait inondé ces sous-sols avec plusieurs mètres d'eau.

Descente dans les sous-sols de la centrale de Bayais
Le commentaire de l'image suivante ;
- Cette pompe prélève l'eau fraîche de la Gironde pour refroidir les réacteurs à l'arrêt et éviter la fusion. A l'époque elle avait été mise hors d'usage par l'inondation.

- De l'eau jusque là ....
- On avait deux pompes en réserve et deux pompes HS ....
En se référant au rapport de l'Assemblée National et du Sénat on verra que deux des pompes, en sous-sol, ont été mises HS par ennoyage de leur moteur électrique.
Le journaliste questionne alors Etienne Dutheil, directeur du centre de Bayais Dialogue :
 .
.
- On a frôlé le pire ?
- Non, on n'a pas frôlé le pire, puisqu'on n'a pas perdu les moyens de refroidissement. C'est un arrêt qui a été géré par les procédures normales et les moyens normaux.
Etienne Dutheil s'efforce de faire passer l'idée que, dès cette époque, cette centrale était "sûre", puisqu'elle a réussi à encaisser cette tempête, totalement imprévue. Personne, au niveau de la conception, n'avait songé une seconde qu'en plaçant les dispositifs de secours en sous-sol (comme les Japonais, pour toutes leurs centrales) on créait une insécurité par manque total de prévoyance.
Langue de bois....
 .
.
La digue a été surélevée et dotée d'une protection anti-houle

- Aujourd'hui la digue, surélevée d'un mètre, avec son pare-houle, nous protégerait d'un événement comme celui de 1999 avec une bonne marge de sécurité
En 1999, un mois avant la tempête, dans une lettre datée du 19 novembre 1999, adressée à EDF, le ministère de l'industrie rappelait qu'il exigeait depuis un an déjà des travaux pour assurer la sécurité de la centrale. La date de la tempête est le 29 décembre 1999.
et aussi, source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucl%C3%A9aire_du_Blayais
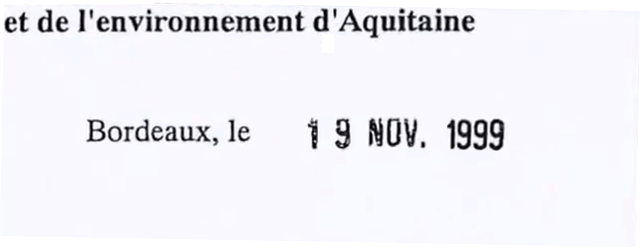
Un mois avant la tempête ......
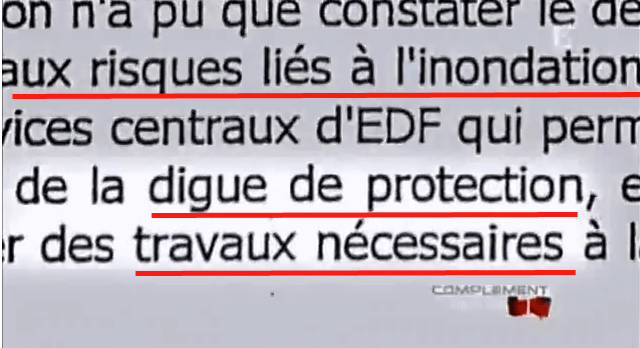
Un rappel à l'ordre insistant, un mois avant l'ouragan ...
Si un ingénieur de la sécurité de la centrale n'avait pas mangé le morceau, en téléphonant à ce journaliste de Sud Ouest, l'incident n'aurait jamais été connu des citoyens français.
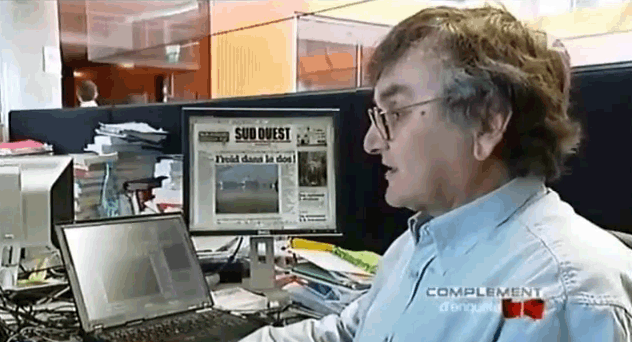
Jean-Pierre Deroudille, journaliste au journal Sud Ouest
- Un ingénieur de la sécurité de la centrale m'a téléphoné en me disant "nous avons eu un incident la nuit de la tempête.
Il s'est passé quelque chose de grave , et on a frôlé la fusion des coeurs nucléaires".
Mon commentaire
Le reportage de l'équipe de Complément d'Enquête a produit un document important, fort. Mais toutes "les bonnes questions" n'ont pas été posées. On s'est concentré sur l'événementiel Imaginez que les journalistes aient dit :
- Quand la tempête imprévue a déferlé sur la centrale de Blayais, les systèmes de secours étaient souterrains, donc inondables, et ils ont été inondés : deux pompes sur quatre ont été mises hors service. Comme nous l'a dit monsieur Patrice Lapouge, la chance a fait que cette tempête s'est produite au moment des "basses eaux", lorsque le niveau de la mer était minimal. Une tempête est une dépression qui se déplace. Donc cette vague qui a provoqué l'inondation était due à la fois au fait que le vent soufflant à 190 km/h poussait la masse d'eau vers la côte et au fait que la dépression avait fait monter le niveau des eaux de (effet de marée barométrique &&& un lecteur nous renseignera sur la rehausse du niveau de l'eau au Blayais, lié à cet effet). Que se serait-il passé si cette tempête s'était produite à une époque de grande marée, où le niveau de la mer aurait été de &&& mètres supérieur (&&& renseignement sur la rehausse de l'eau dans cette région, par effet de marée, SVP). Pensez vous que la centrale aurait alors pu compter sur 2 pompes en état sur quatre ? Que serait-il passé si les quatre pompes avaient été HS ? Quelles étaient "les procédures normales" prévues dans un tel cas de figure ? Par ailleurs, le vulnérabilité de l'installation est essentiellement liée au fait que les systèmes de pompages de secours sont en sous-sol, donc inondables. A priori les cuves à fioul et les groupes électrogènes sont aussi en sous-sol, ou l'étaient à l'époque. Le sont-ils toujours, 12 ans après cette tempête ? Pourrions-nous maintenant les visiter ? Avez-vous effectué des travaux pour mettre ces éléments-clé de la "sûreté" hors de portée des eaux, en hauteur ?
La précision n'a pas tardé à arriver, émanant d'une employée d'EDF : Non, des travaux de " mise hors d'eau du diesel alimentant les pompes de secours de la central du Blayais n'ont jamais été effectués. L'ensemble est toujours insondable. Mais "c'est en projet", depuis la catastrophe, de 1999 et, au moment où j'écris ces lignes, tout est resté en l'état depuis 12 ans !!! Ces gens ont des incompétences des irresponsables et des cons. Il se foutent simplement de votre gueule. Ça ne date pas d'hier et ça continuera. C'est honteux, scandaleux. LE JEUNE DIRECTEUR DE LA CENTRALE, QUI N'A QUE LE MOT "SÛRETÉ" À LA BOUCHE, EST PARFAITEMENT AU COURANT. CES GENS SONT DES CONS. |
Suite à message d'un lecteur :
Bonjour Mr Petit, Par curiosité j'ai recherché tusnami et Blayais. il y a 500ans un Tremblement de terre sur la faille de lisbonne à déclenché l'engoutissement d'un village (voir dans les commentaires): Ce premier lien nous donne la carte des tsunamis français : avec le texte suivant :
notre pseudo "encyclopédie libre" en parle: http://fr.wikipedia.org/wiki/Tremblement_de_terre_de_Lisbonne (8,5 à 8,7 sur l'échelle de Richter) La propagation du tsunami qui détruisit le port de Lisbonne (l'épicentre était en mar, au large) Une vague de 15 mètres sur la côte sud-ouest de l'Espagne, de 20 mètres de haut sur le Maroc, de 3 mètres sur le sud de l'Angleterre
le CNRS en parle aussi: http://www2.cnrs.fr/presse/thema/750.htm et un sénateur à fait un rapport, recommandant un système d'alerte pour la facade Atlantique: http://www.sudouest.fr/2011/03/20/un-systeme-d-alerte-au-tsunami-pour-l-atlantique-347951-5010.php Si vraiment les pompes et groupes électrogène du Blayais sont toujours inondables, nous avons du soucis à ce faire, et à trouver des moyens d'informer nos voisins. bonne journée Pascall
Il faut absolument que Claude Allègre, ancien ministre et spécialiste de tectonioque des plaques, qui dit que la France n'est pas sujette à la sismicité, se renseigne. |
Autre type de question :
- La centrale de Blayais fonctionne au MOX, c'est bien ça ? Ce nouveau combustible est composé de 93 % d'uranium 238, non fissile, et de 7 % de plutonium, fissile. Les centrales chargées au MOX "fonctionnent donc au plutonium" et non à l'uranium. C'est un changement majeur. Pourquoi opère-t-on actuellement ce changement, présent dans 20 % de nos centrales, qui consiste à remplacer le combustible à base d'uranium enrichi à 3 % par un autre type de combustible, contenant du plutonium. Serait-ce pour des raisons "économiques", parce que les installations de la Hague sont "très performantes" pour opérer par voie chimique, moins onéreuse, cette extraction du plutonium, jusqu'à présent considéré, soit comme un explosif nucléaire, soit comme un déchet ? Dans ces centrales au MOX c'est le plutonium qui produit l'énergie par des réactions de fission. Comme les coeurs sont refroidis par de l'eau, celle-ci, jouant son rôle de modérateur, de ralentisseur de neutrons, cela empêche les actuelles centrales de fonctionner en surgénérateurs, de produire d'abondantes quantités de plutonium, l'uranium 238, faisant fonction de "diluant" dans le mélange capturant des neutrons émis et se transformant en plutonium 239. Ce fonctionnement au MOX ne préfigure-t-il pas un passage ultérieur aux surgénérateurs ? Ce MOX (Mixed oxydes : mélange d'oxyde d'uranium 238 et d'oxyde de plutonium 239) ne constitue-t-il pas le mode de chargement des futurs surgénérateurs, dont le "déploiement" est pour le moment bloqué. Avant de parler des surgénérateurs, où le modérateur est cette substance hyper-dangereuse qu'est le sodium, lequel s'enflamme spontanément à l'air et explose au contact de l'eau, cette formule du MOX n'est-elle pas un glissement discret, une préparation à un passage à la formule du surgénérateur ?
En un mot comme un seul, EDF cherche-t-il a accroître la "sûreté" ou priorise-t-il la rentabilité, et le fait de satisfaire les besoin de l'armée en plutonium de qualité militaire au détriment de la sécurité des citoyens français ? ..
L'enquête réalisée par Elise Lucet, sur les déchets radioactifs planqués ici et là sur le territoire français. A voir ou revoir: Le Scandale de la France contaminée. http://www.mefeedia.com/watch/33642140 ou http://www.wat.tv/video/uranium-scandale-france-contaminee-1tutm_2hpl3_.html http://www.wat.tv/video/uranium-scandale-france-contaminee-1tuzj_2hpl3_.html http://www.wat.tv/video/uranium-scandale-france-contaminee-1tv1f_2hpl3_.html http://www.wat.tv/video/uranium-scandale-france-contaminee-1tv4d_2hpl3_.html http://www.wat.tv/video/uranium-scandale-france-contaminee-1tv6c_2hpl3_.html http://www.wat.tv/video/uranium-scandale-france-contaminee-1tvfz_2hpl3_.html |
LE MOX EST LA CLE DE TOUT Je suis comme vous. Je découvre les choses au fur et à mesure et je répercute des informations, dans ce feuilleton de l'imbécilité et de l'irresponsabilité criminelle. Et vous allez en apprendre de belles. Depuis l'après guerre, selon le souhaite de de Gaulle, le nucléaire français a été placé sous le signe des applications militaires. Il fallait que la France ait "sa" bombe, "ses" missiles" et "ses" sous-marins nucléaires, pour entrer dans le concert des grandes nations...
A l'adresse ci-après, vous trouverez des extraits d'un ouvrage décrivant la politique nucléaire française, l'édition français ayant été publiée en 1988 au éditions l'Harmattan |
Suite :
On lira, page 45, que la couverture fertiles du surgénérateur Phoenix de Marcoule fournit du plutonium de qualité militaire. Il produit de 75 à 100 kilos de plutonium par an. Le surgénérateur Phoenix s'intégrait dans le programme militaire français, camouflé en programme civil. Depuis la fin de la guerre de 39-45 c'est l'Armée qui mène le bal, au mépris le plus complet des vies humaines.
Vous pourrez toujours vous procurer un exemplaire de ce livre, si vous nourrissez encore quelques illusions. Mais revenons à cette question du MOX. On pouvait lire que ce MOX était un mélange d'oxydes d'uranium et d'oxydes de plutonium. On aurait pu ainsi penser que ce nouveau combustible (Fukushima nous en a fait connaître l'existence, puisque le réacteur numéro 3 japonais était chargé avec celui-ci, de fabrication français) était une sorte de variante d'un combustible classique, basé sur de l'uranium 235 à x %, "dopé au plutonium". Pas du tout. Le MOX est un mélange de 93 % d'uranium 238 et de 7% de plutonium 239 ! On est confronté à un changement qualitatif radical : celui du fonctionnement des "nouveaux réacteurs" en utilisant la fission du plutonium 239 et non de l'uranium 235. Pourquoi ce virage ?
Pour deux raisons. - La France dispose d'un stock important de plutonium d'origines diverses, produit par ses réacteurs, dont du plutonium de qualité militaire, détenu maintenant en quantités excessives. - La France a procédé à une récupération du plutonium présent dans les assemblages usagés, issus de ses propres réacteurs, et des assemblages que lui envoient les pays voisins, et qui arrivent pas trains entiers. Cette récupération est effectuée à l'usine de retraitement de la Hague. - Les Français "sont très en point" dans ce domaine de l'extraction du plutonium par voie chimique, comme nous l'explique notre "ami AREVA", société privée.
Le pdf où AREVA nous présente sa superbe unité de récupération et de conditionnement de plutonium
Et voici ce document AREVA de deux pages :
Effectuez un zoom sur la seconde planche. Vous lirez :
"Batch" en anglais se traduit par "fournée". La boulangerie du diable. Chaque "petit pain" de plutonium représente 3 kilos. Avec une densité de 19 grammes par centimètre cube, ceci correspond à un cube de 5,4 cm de côté. La masse critique du plutonium était de 8 kilos, avec trois petits pains, vous avez de quoi faire une bombe A. Chaque fournée donne de quoi faire 200 bombes atomiques. Cette démarche me fait penser à la page 34 de la bande dessinée de Mézières " Les Cercles du Pouvoir ", dans la série des aventures de Valérian. |
Je la sors du tableau pour qu'elle soit plus lisible.
Je me demande si la tête d'Etienne Dutheil ne présenterait pas un début de processus de ce genre.

28 avril 2011 : Après avoir traité cette première partie en la terminant par une boutade, résumons.
Le nucléaire, en France, est né du rêve de grandeur d'un général dont le cynisme et le mahiavélisme ne sont plus à démontrer. Sous sa poigne de fer, la France s'est dotée de l'arme nucléaire, a construit des sous-marins nucléaires (pour dissuder qui, maintenant ?). Toutes ces opérations ont été menées dans le plus complet mépris des populations civiles, tant françaises qu'étrangères, nord-africaines ou polynésiennes.
A propos du stockage, discret, des sous-produits du traitement du minerai d'uranium disponible sur le territoire français, référez vous oui revoyez cette enquête, menée par la journaliste Evelyne Lucet :
|
De Gaulle a testé les armes françaises dans le Sahara, et plus tard en Polynésie, en foutant complètement en l'air cette région de rêve. Quand j'aurai du temps je vous expliquerai tout cela. Au départ, comme c'était moins compliqué de creuser dans le calcaire formé par l'accumulation coralienne, c'est là qu'on été effectés les premiers tirs souterrains.
Un jour un effondrement de terrain a fait se détacher une énorme plaque de calcaire, qui a provoqué un tsunami, qui a été ressenti dans les îles environnantes. Pourtant " les études avaient montré que ....".
Alors les ingénieurs ont construit des plateformes anti-tsunami, sur lesquelles ils allaient se jucher, pendant les tirs. Il faudra que je scanne le bouquin " Les Atolls de la Bombe " et que je mette le pdf en ligne, ouvrage qui m'a été prêté par Christiant Nazet, ingénieur militaire, ex-responsable de l'instrumentation, sur l'atoll.
Vous verrez les océans de fric qu'on a dépensé pour que le général ait sa bombinette.
.