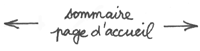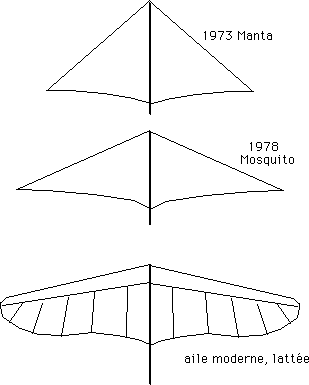
Texte mis à jour le 12 juillet 2007
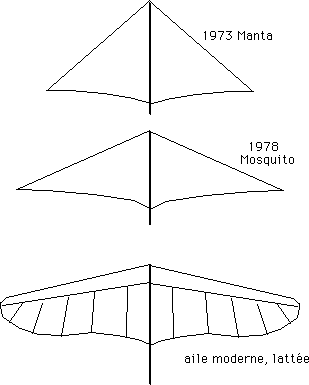
...Sur le dessin ci-après, le dispositif anti-mise en drapeau, anti-piqué, tel qu'il existe actuellement sur toutes les ailes. Aux extrémités on trouve des "déflexeurs" ou "floatings", plantés dans le tube bord d'attaque. Les extrémités des lattes sont également reliées au sommet du mât par des haubans.
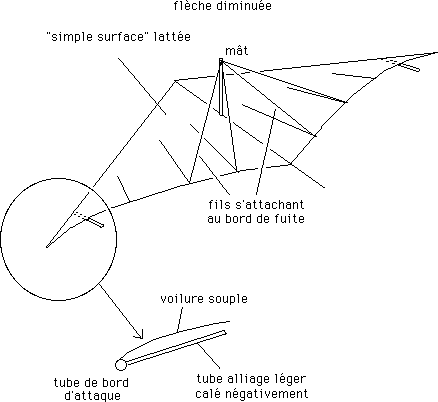
De cette façon, toute la partie grisée de la voilure participe au redressement de la machine, en cas de mise en piqué accidentelle.
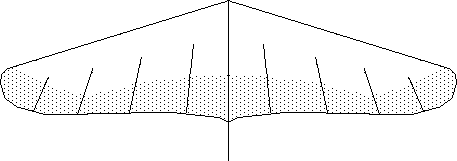
...Entre cette forme actuelle et les machines des débuts :un parcours jonché de nombreux morts. Dans les dessins ci-après, la structure d'une aile delta moderne :
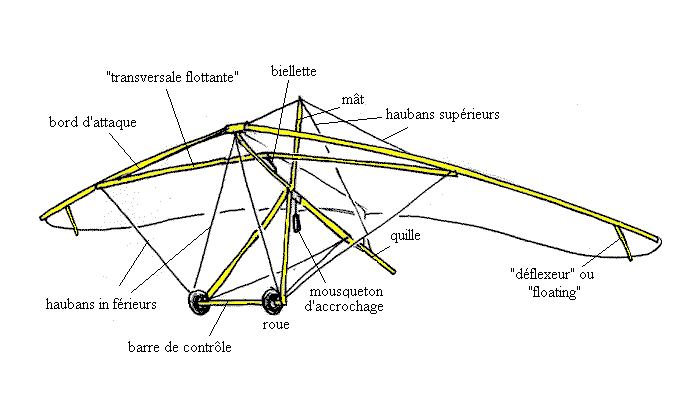
La "charpente" de l'aile : tubes et câbles.
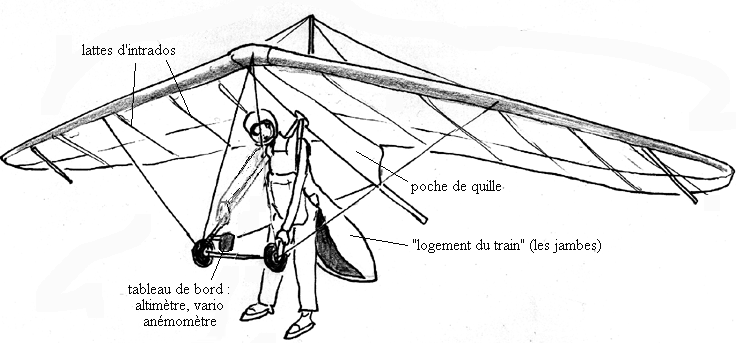
...Le harnais a beaucoup changé. Il y a vingt six ans on volait debout, suspendu dans un harnais de type parachute. Puis est venu le pilotage couché. Au décollage le pilote courait en tenant entre les dents une partie de son harnais-cocon, dans lequel il devait alors installer ses jambes en de contorsionnant. Puis quelqu'un a eu l'idée folle de munir ces harnais d'une sorte d'abdomen de guèpe, visible sur le dessin ci-dessus. Aussitôt après le décollage, le pilote "rentre alors le train", c'est à dire enfile ses deux jambes dans ce sac, qu'il ferme ensuite en manoeuvrant manuellement une fermeture-éclair. Le plus extraordinaire est que tout cela se déroule sans problème.
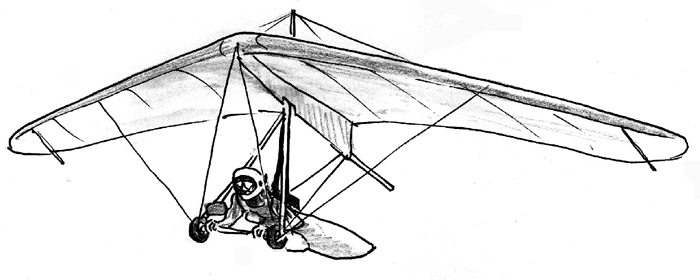
...Voilà à quoi je
ressemble, sous mon "Nuage" Tecma, après avoir décollé ( ma propre machine ) .
Sur le ventre, le parachute de secours. Une aile avec laquelle on peut bien
s'amuser, faire de la distance, affronter des turbulences. Une aile saine, à
la fois côté structure et qualités de vol. Bien sûr,
il ne faut pas faire l'imbécile, aller se balader sous des cumulus en
train de se transformer en cunimbes, en cumulo-nimbus ou près de reliefs à rouleaux.
...A l'atterrissage, on tire sur une autre fermeture-éclair
et on "sort le train". Cette manoeuvre n'en finit pas de me réjouir.
Qui aurait cru, il y a vingt cinq ans, qu'émergeraient un jour de tels
dispositifs (à l'époque où j'atterrissais sur des skis
transformés, à l'aide de roues de poussette. Heureusement, cela
n'a pas duré longtemps).
L'aile libre, aujourd'hui.
...Peut-on dire que tous les problèmes soient résolus, dans cette branche de l'ultra-léger? Disons que les machines ont pas mal progressé. Mais ce qui est navrant c'est que ces progrès se soient effectués parce que de nombreuses personnes sont mortes. Pourquoi ? Parce que ce sport qu'est l'ultra-léger a poussé comme une plante sauvage. Ma tête est lourde de souvenirs tragiques. Un jour un constructeur a sorti une aile à double surface. La performance s'est aussitôt accrue. De nos jours, abondamment lattées sur l'extrados et l'intrados, ces ailes de Dacron finissent par ressembler quasiment à des ailes d'avions. Dotées de forts allongements elles n'ont pratiquement plus rien à voir avec les Manta des années-soixante-dix. En passant au "double surface" la finesse augmentait, la traîné diminuait, de même que le taux de chute. Mais, avec cette aile-là, quand, en virage on partait en glissage, l'engin piquait du nez.
...De nouveau, de morts. Il fallut que des pressions soient exercées sur le constructeur pour que le scandale cesse.
...Fallait-il automatiquement que des gens se tuent pour ce sport progresse à nouveau "en toute liberté" ? Non, on aurait pu essayer ces matériels en soufflerie. A l'ONERA, l'ingénieur Claudius Laburthe disposait de la grande soufflerie de Chalais Meudon où les ailes pouvaient être testées en vraie grandeur. Cette soufflerie est-elle toujours disponible ? L'était-elle encore à l'époque ? Ne pouvait-on faire des essais sur maquettes, éventuellement télécommandées ?
Tout cela coûte cher, objectera-t-on ? Mais à combien évalue-t-on la vie d'un homme ?
...Il y a dix ans mon ami Michel Katzman, avec qui je volais depuis 15 ans, se tua bêtement. Il avait été l'un des pionniers de ce sport et possédait une grande expérience. Rupture d'une pièce en vol. Il volait sur un biplace, avec un passager, sans parachute de secours. Cette pièce, la voilà, grandeur nature :
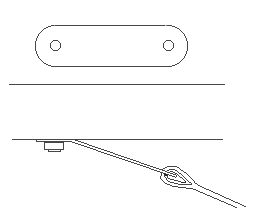
...L'indication de la fixation n'est ici que schématique, mais on voit qu'il s'agit d'une simple "patte à trous" en inox qui permet de fixer un hauban inférieur à la structure tubulaire de l'appareil. Cette patte s'est rompue en vol. Michel et son passager se sont retrouvés emprisonnés dans un cercueil de toile, de câbles et de tubes brisés. Pendant la chute il cria, on l'entendit très bien du sol : "ferme les yeux, on est foutus!". Pendant cette descente interminable, Michel a dû se dire "je n'ai jamais cru au parachute. Mais là, cela pourrait peut être nous faire de l'usage…"
...Aucune patte à trou
n'avait jamais cassé sur aucun delta, depuis les débuts. Alors,
pourquoi ?
La fatigue des matériaux.
...Tous les ingénieurs de l'aéronautique vous le diront : ce qui mène le jeu dans le dimensionnement des pièces, en aéronautique, ça n'est pas tant la résistance statique que la résistance à la fatigue. Vous avez tous coupé un fil de fer, ou une tôle, en pliant et en dépliant le matériau maintes fois. Alors le métal "fatigue" et finit par se rompre. Dans ce cas-là, on force les choses. Mais toute pièce métallique, soumise à des efforts alternés fatigue, sa résistance à l'effort s'en trouve progressivement amoindrie. Cela peut être une pale de rotor qui travaille en flexion, la paroi de la cabine d'un liner, qui subit à chaque vol pressurisation et dépressurisation. Cela peut être .. n'importe quoi. Une patte à trous, par exemple.
...Je vais vous raconter une histoire qui s'inscrivit en lettres de sang dans l'histoire de l'aéronautique internationale. Après la guerre les Anglais lancèrent une machine incroyablement en avance sur son temps : le quadriréacteur Comet. C'était le premier du genre. On sait que les Anglais avaient été les leaders en matière de propulsion à réaction, juste à la fin de la guerre, avec leur "Gloster Meteor". Le Comet était racé, séduisant, rapide. Puis, quelques mois après la mise en service de dizaines d'unités il y eut une série impressionnante d'accidents inexplicables. A chaque fois, cent passagers perdaient la vie. Les appareils furent interdits de vol et la maison de Havilland vit toutes ses commandes annulées. Des équipes nombreuses furent mises au chômage technique.
...On savait une chose : les accidents
s'étaient tous produits au bout d'un certain nombre de vols. Il n'y avait
pas de boites noires, à l'époque. Lorsque les accidents se produisaient,
les pilotes n'avaient pas le temps de lancer le moindre appel de détresse,
comme si les avions avaient littéralement explosé en vol.
Eh bien c'est exactement ce qu'ils faisaient. Pour en arriver à cette
conclusion, on simula la pressurisation-dépressurisation en enfermant
une carlingue de Comet dans un caisson. Et les essais commencèrent. Au
bout d'un certain nombre de cycles, la coque de l'appareil céda au niveau d'un hublot. Ce nombre s'avéra proche des cycles subis par l'appareil lors de son début d'exploitation commerciale.
...Il est pratiquement impossible de prévoir les phénomènes de fatigue. Le problème est trop complexe. La seule solution consiste à tester les matériaux, les structures complètes. Dans des bancs d'essai spécialement conçus pour cet usage des trains d'atterrissages d'avion subissent inlassablement les chocs correspondant à l'impact sur les pistes, des voilures subissent des flexions alternées, commandées par de simples vilebrequins, qui simulent les efforts dus aux rafales. Cela peut aller jusqu'à cent millions de cycles.
En fait la résistance du matériau décroît en partant de la valeur qu'elle a en statique. Cette courbe de décroissance s'appelle la courbe de Wohler, je crois me rappeler. certains structures, soumises à des contraintes données, voient leur résistance décroître, puis se maintenir à une valeur constante. Si celle-ci excède la mis en charge de la structure dans une utilisation normale on en déduira que celle-ci est " bonne pour le service ".
...L'industrie aéronautique s'est fixé des normes, a adopté des coefficients de sécurité. Aujourd'hui, quand on pose ses fesses dans un avion de ligne, on peut être certain que tous ses composants on été testés, aux chocs, au froid, à la chaleur. La sécurité est à ce prix.
...Même chose pour les "petits avions", les biplaces, les quadriplaces, qui ne sont pas fabriqués n'importe comment mais calculés et testés à la fatigue. Il en est de même pour ce qu'on appelle "l'aviation légère". La construction amateur se porte bien, mais elle est encadrée. Prenez l'exemple d'un petit monoplace assez célèbre, le "Cri-Cri", propulsé au départ par deux moteurs de … tondeuse à gazon. Au départ un homme l'a conçu, dessiné, construit. Mais il a déposé un dossier de calcul, qui a été examiné par des gens compétents. Il a testé son appareil aux efforts, à la fatigue, en respectant des normes en vigueur. La résistance mécanique d'une aile dépend au premier chef d'un "longeron". L'inventeur du Cri-Cri a testé lui-même le sien, avec un excentrique monté sur un moteur électrique. Cent millions de cycles. Le test a été validé. L'inventeur a reçu le feu vert pour commercialiser son produit. Aucune aile de Cri-Cri n'a jamais cassé en vol.
...Et dans le domaine de l'ultra-léger ? Hélas, rien de semblable ( &&& écrit en 2001. Mais il y a gros à parier que six ans plus tard la situation n'a pas changé ). Dans ce terrain-là, nous en sommes au temps des frères Wright qui, comme on le sait, avaient débuté dans la vie comme fabriquants de cycles. Personne n'avait calculé ou essayé la patte à trous dont la rupture entraîna la mort de mon ami. "Ca avait l'air assez épais pour tenir", c'est tout. On ne peut pas en vouloir au constructeur : aucune réglementation ne l'obligeait à faire ce type de test et que crois bien qu'il ignorait tout simplement le sens du mot "fatigue des matériaux".
...En effort statique, la pièce pouvait encaisser plusieurs fois les efforts les plus violents. Mais personne n'avait testé sa résistance à la fatigue, ni même songé à le faire. Pourtant c'eût été simple. Un bâti, un excentrique, tractions, flexions, des milliers, des millions de fois, simulant dix fois, cent fois les efforts subis par la pièce dans les conditions les plus dures, bien au-delà de la durée de vie de la machine.
...La patte à trous qui s'est brisée avait été découpée dans de la tôle inox de quinze dixièmes d'épaisseur. Avec du deux millimètres elle n'aurait jamais cassé. Toutes les épaisseurs des pattes à trou ont été par la suite contrôlées, et certaines révisées à la hausse. Mais pour cela, il a fallu deux morts, deux de plus.
...Je n'en veux pas au constructeur, Mallinjoud. Le pauvre a passé suffisamment de nuits blanches à cause de ce drame qui coûta la vie à un homme qui était aussi son ami, et le sien. C'est le système qui déconne complètement. Pas de normes, pas de contrôles périodiques, pas d'exigence de port d'un casque, d'emport d'un parachute de secours. Rien qu'une splendide liberté.
...Au plan de la construction, dans l'ULM règne la gabegie la plus totale ( &&& écrit en 2001. Si les choses ont changé, me le dire ). Nous y consacrerons un dossier complet. Dans ce domaine, c'est le plat de résistance. Je me contenterai de citer un fait récent, ô combien révélateur. Un de mes amis attira il y a quelques mois mon attention sur une idée qui semblait séduisante par sa simplicité. Quelqu'un s'était mis en tête de construire des ULM en utilisant de simples échelles en dural de récupération. Il en avait racheté tout un lot dans une grande surface à bas prix. Léger, relativement solide. L'homme avait opté pour la formule "pou du ciel".
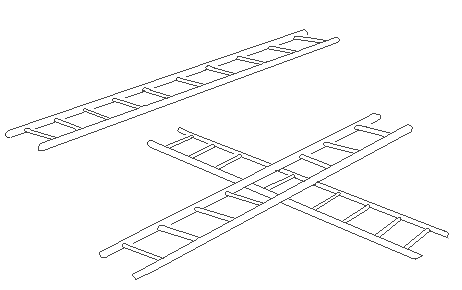
La partie "structurelle" de cet ULM révolutionnaire :
Trois échelles en alliage léger.
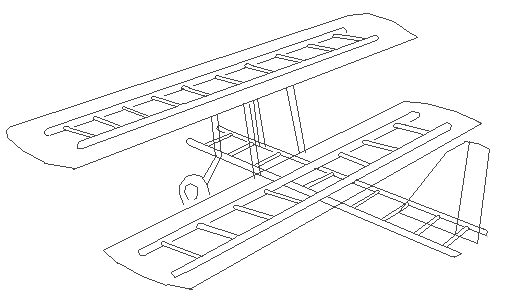
Le même, "habillé".
...Bien sûr, ça vole. Avec cinquante chevaux on peut faire décoller un ULM fabriqué avec n'importe quoi. Mais jetons un śil, de près, à ces fameuses échelles.
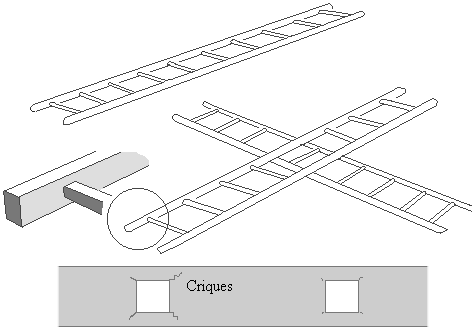
...N'importe quel ingénieur débutant vous expliquerait que ces trous carrés, dans lesquels viennent s'enficher ces montants d'échelle, constituent des lieux idéaux d'apparition de "criques", sous l'effet des efforts de flexion et de torsion, avec, au bout du chemin, la rupture en vol. Mais qui contrôle les brillants essais de ce "créateur d'emplois" ? (j'ai même entendu parler de "subventions"). Quel service technique est habilité, mandaté, pour aller fourrer son nez dans cette affaire-là ? Aucun. En matière d'ULM n'importe qui peut fabriquer n'importe quoi, n'importe comment, et le vendre au premier venu, disposant ou ne disposant pas de son brevet de pilote. Le saviez-vous ?